Afrique : Les lanceurs d’alerte, nouveaux acteurs du pouvoir et de la démocratie
- Amadou Diallo
- 11 nov. 2025
- 2 min de lecture

Bamako, novembre 2025 — Longtemps perçus comme de simples dénonciateurs, les lanceurs d’alerte s’imposent désormais comme des figures incontournables du paysage politique africain. Entre quête de transparence, pression citoyenne et déficit de protection juridique, ils redéfinissent les rapports entre gouvernés et gouvernants, bousculant les codes de la gouvernance traditionnelle sur le continent.
Un statut encore précaire malgré une influence croissante
En Afrique, la condition des lanceurs d’alerte reste fragile. Si certains pays anglophones — comme le Ghana, le Nigeria ou le Liberia — ont amorcé une reconnaissance légale et sociale de leur rôle, la situation demeure plus complexe dans les pays francophones, où ces acteurs sont encore souvent assimilés à des « dénonciateurs ».
Malgré la mise en place d’une plateforme panafricaine de protection des lanceurs d’alerte, le cadre juridique reste insuffisant. Dans plusieurs États, ces citoyens courageux s’exposent à la répression, à l’isolement professionnel, voire à des poursuites judiciaires, pour avoir simplement révélé des faits contraires à l’intérêt public.
Des gardiens de la transparence devenus acteurs politiques
Apparus sur la scène publique principalement à travers la lutte contre la corruption, les lanceurs d’alerte ont progressivement élargi leur champ d’action. Aujourd’hui, ils interviennent sur des sujets touchant à la gouvernance, aux droits humains et à la justice sociale.
Leur influence dépasse désormais le cadre de la dénonciation : ils contribuent à façonner l’opinion publique et à orienter le débat politique. À bien des égards, ils rappellent ces figures ancestrales africaines — « sorciers » ou « voyants » — investies d’un pouvoir moral et symbolique de veille sur la société.
Une pratique en mutation dans l’Afrique francophone
Dans les sociétés francophones, la montée des lanceurs d’alerte soulève de nouveaux questionnements : servent-ils uniquement la cause de la transparence ou deviennent-ils parfois des acteurs de déstabilisation ?
L’essor des réseaux sociaux et du numérique a accentué cette dualité, donnant naissance à une nouvelle génération d’influenceurs-citoyens, à mi-chemin entre militantisme et journalisme. Leur parole, largement relayée en ligne, met à l’épreuve les limites des régimes politiques africains et pousse à un réexamen profond des pratiques démocratiques.
Ousmane Sonko, le symbole d’une transformation politique
L’exemple du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko illustre parfaitement cette évolution. En 2016, alors inspecteur des impôts, il avait révélé des avantages fiscaux accordés à de hauts responsables sénégalais. Radié pour manquement au devoir de réserve, il s’est imposé au fil des ans comme l’une des figures politiques les plus influentes du Sénégal.
Son parcours démontre comment un lanceur d’alerte peut se transformer en acteur politique majeur, voire accéder au pouvoir. Ce cas emblématique témoigne du rôle grandissant de l’alerte comme levier d’engagement citoyen et outil de changement politique.
Vers une nouvelle ère démocratique africaine
Face aux aspirations croissantes à la transparence et à la redevabilité, les lanceurs d’alerte apparaissent comme une opportunité historique pour les sociétés africaines. Leur action oblige les États à repenser leurs modes de gouvernance et à s’adapter aux exigences d’une population mieux informée et plus exigeante.
En redéfinissant les frontières entre pouvoir, information et citoyenneté, ces « faiseurs de vérité » participent à l’émergence d’une nouvelle conscience politique africaine — celle d’un continent en quête d’une démocratie authentiquement participative.
Source : Bamako bamada
Haoua SANGARÉ
LETJIKAN





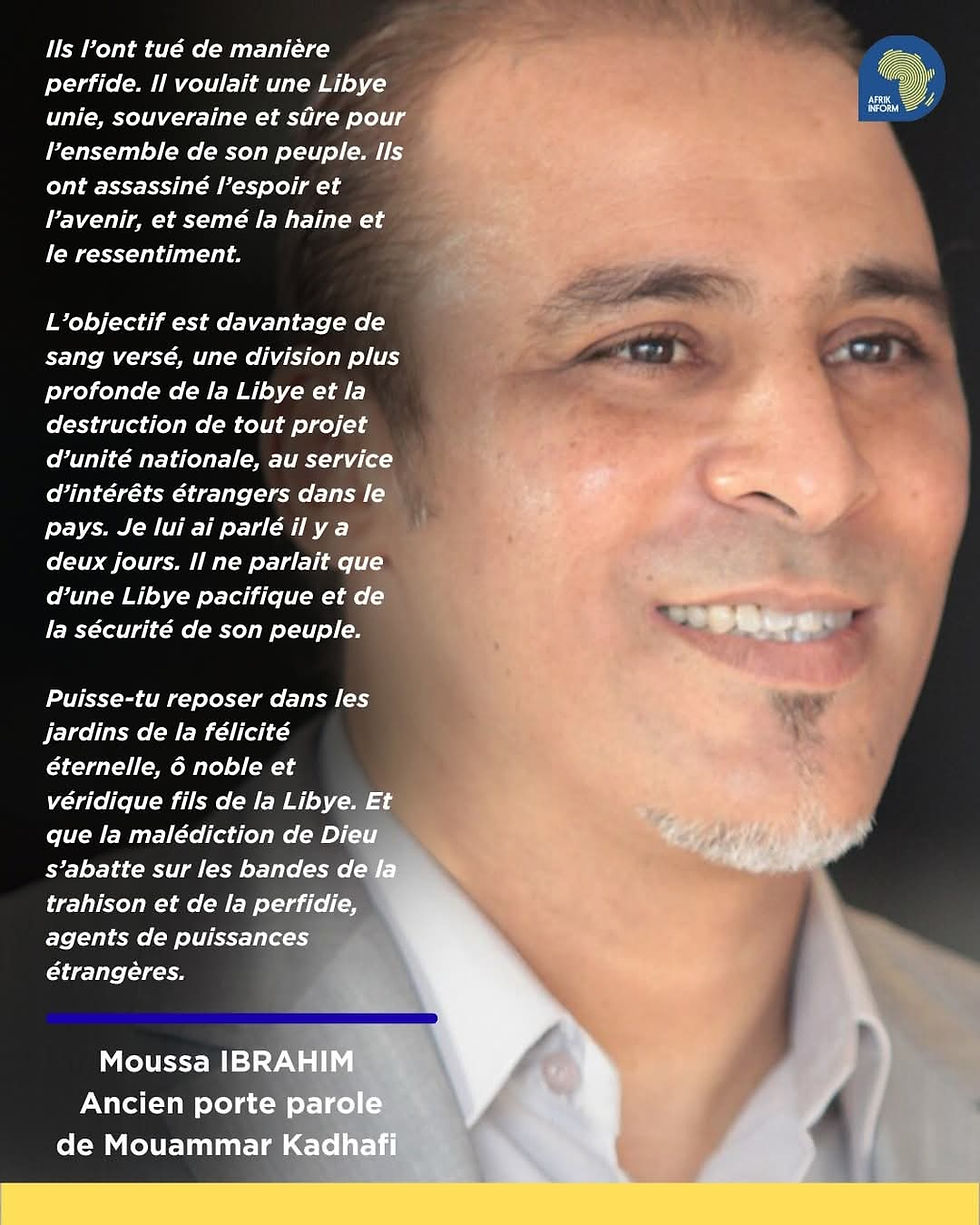


.jpg)












Commentaires