Cameroun : le métier de « bensikineur », entre survie économique et danger permanent
- 10 nov. 2025
- 3 min de lecture

Face au chômage massif et à l’insuffisance des transports publics, le métier de conducteur de moto-taxi, communément appelé « bensikineur », s’est imposé comme une véritable bouée de sauvetage pour des milliers de Camerounais. Présents aussi bien dans les grandes villes que dans les zones rurales, ces transporteurs comblent un vide dans le système de mobilité urbaine, tout en révélant les limites des politiques d’insertion professionnelle.
Une solution née du chômage et du manque d’infrastructures
Autrefois simple moyen de déplacement personnel, la moto est devenue un outil de travail pour une jeunesse en quête de revenus. Le déficit de bus, la rareté des taxis et le chômage endémique ont transformé cet engin à deux roues en une source de subsistance.
Pour exercer légalement, il faut disposer d’un permis de conduire de catégorie A, d’une assurance, et s’acquitter de l’impôt libératoire. Mais dans les faits, le secteur reste largement informel.
Un métier accessible à tous les profils
Le monde des bensikineurs rassemble des profils variés : étudiants, diplômés sans emploi, pasteurs, retraités, ouvriers ou agriculteurs. Pour beaucoup, il s’agit d’un choix par nécessité.
« J’exerce ce métier malgré moi, confie George N., ancien de l’Église. Les risques sont énormes : une simple distraction peut coûter la vie. Si vous allez au pavillon des blessés à l’hôpital Laquintinie de Douala, vous verrez l’ampleur du drame », témoigne-t-il, évoquant les nombreux accidents dont sont victimes les conducteurs.
Entre préjugés et réalité sociale
Souvent perçus comme des marginaux, les bensikineurs sont pourtant nombreux à être diplômés ou artisans qualifiés.
« Avant d’entrer dans ce milieu, je pensais qu’ils étaient tous analphabètes ou délinquants », reconnaît Félix O., plombier de formation. « Mais j’ai découvert des jeunes diplômés sans emploi, forcés d’enfourcher une moto pour survivre. Nos dirigeants n’ont rien prévu pour leur insertion. Ils forment, mais ne recrutent pas. »
Cette réalité souligne l’absence d’une véritable politique nationale d’emploi des jeunes. Malgré les discours officiels saluant le courage des conducteurs de moto-taxis, peu d’initiatives concrètes ont été mises en œuvre pour encadrer ou sécuriser la profession.
Une activité complémentaire pour certains travailleurs
Pour d’autres, la moto-taxi constitue un revenu d’appoint.
« Je travaille dans une société, mais la moto me permet de nourrir mes enfants », explique René H., boulanger. « Je respecte les zones autorisées et j’évite les risques inutiles. Malheureusement, beaucoup refusent de se conformer à la réglementation, rendant toute tentative d’identification difficile. »
Un équilibre fragile entre utilité et danger
En zone rurale, la moto joue un rôle essentiel dans la vie économique. Jean-Pierre F., agriculteur, alterne entre champs et transport de passagers :
« Ce métier me permet de compléter mes revenus et de transporter mes récoltes. Mais il est dangereux : nombreux sont ceux qui deviennent handicapés ou y perdent la vie. »
Selon lui, le tarif plus élevé pratiqué dans les villages pousse de nombreux jeunes à retourner à la campagne, où la moto-taxi rapporte davantage qu’en ville.
Le reflet d’une précarité généralisée
Pour la couturière Pascaline T., la crise postélectorale et le confinement ont mis en lumière la fragilité économique des Camerounais :
« J’ai vu la misère à ciel ouvert. Beaucoup vivent au jour le jour. Sans activité, ils n’ont rien pour manger. Si le confinement avait duré plus d’une semaine, la famine aurait poussé les gens à descendre dans la rue. »
Un métier vital mais à encadrer
Le phénomène des bensikineurs illustre les débrouilles quotidiennes d’une jeunesse laissée à elle-même. S’il pallie l’insuffisance du transport public, il met aussi en lumière les failles de la gouvernance sociale et les dangers d’une économie informelle.
Entre espoir, survie et insécurité, le métier de moto-taximan reste à la fois indispensable et précaire, symbole d’un Cameroun en quête de solutions durables pour sa jeunesse.
Source: Afrik.Com
Haoua SANGARÉ
LETJIKAN




.jpg)






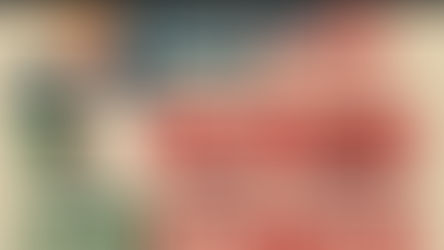





Commentaires